« Le bonheur en entreprise : une utopie ? » Pour répondre à cette délicate question, le Medef Somme avait convié pour sa soirée gala du 28 novembre 2019 une conférencière de marque : Julia de Funès (petite fille de). La philosophe, qui a notamment co-écrit avec Nicolas Bouzou La comédie (in)humaine. Comment les entreprises font fuir les meilleurs, s’est lancée dans une brillante démonstration de philosophie appliquée à l’entreprise, devant l’amphithéâtre comble de l’Hôtel Bouctot-Vagniez d’Amiens.
Dans une vie antérieure, Julia de Funès était chasseuse de tête. C’est dire si elle connaît les codes de l’entreprise, qu’elle s’attache à décortiquer, au fil des nombreuses conférences qu’elle délivre. La philosophe a débuté son propos sur les modes de fonctionnement de l’entreprise et sur certaines de ses normes comportementales et langagières managériales Premier constat : « Aujourd’hui, nous vivons en France dans un climat très anxiogène. C’est intéressant du point de vue philosophique de se dire qu’on vit avec l’angoisse, alors que depuis l’Antiquité les philosophes ont toujours dénigré ce sentiment, parce qu’il altère les représentations, et qu’il éloigne du rationnel. Or devenir un adulte, c’est apprendre à avoir de moins en moins peur… » L’entreprise étant un catalyseur de ce qui passe de façon globale dans la société, la peur y est aussi logiquement présente. « Dans les entreprises, on légifère énormément et on procédurise à peu près tout, dont les façons de faire, qui donnent l’impression de sécuriser les choses et qui très souvent engourdissent les esprits. » Si Julia de Funès ne dénigre pas dans l’absolu les process, elle en critique l’usage quand le sens en est perdu et que la procédure est appliquée pour la procédure, au risque d’infantiliser les collaborateurs.
« Il faut avoir les capacités d’agir pour se sentir bien »
Bonheur et performance
Après cet aparté, la philosophe est revenue sur le thème central de la soirée : le bonheur en entreprise. « C’est aujourd’hui devenu une injonction, un process : il faut le faire parce que ça fait bien, on met donc en place la QVT, des Chief Hapiness Officer [ndlr, CHO – responsables du bonheur] et d’autres protocoles destinés à rendre les salariés plus heureux. Pour moi, clairement le bonheur en entreprise pensé de cette façon est une utopie. » Comme l’a expliqué Julia de Funès : prétendre rendre les gens heureux représente une énorme responsabilité, d’autant que les dirigeants ou managers qui voudraient le faire sont sûrs de ne jamais parvenir à leurs fins : « Le bonheur est absolument indéfinissable, depuis 3 000 ans, les philosophes essaient de le définir sans succès. Il est trop personnel et subjectif pour qu’on prétende le normer ou le formater. »
Ce qui explique en partie ce « paradoxe » : alors que jamais les dirigeants n’ont fait autant pour le bien-être de leurs équipes, il n’y a jamais eu autant de mal-être au travail (augmentations des arrêts maladie longue durée, burn-out…). Pour Julia de Funès, être heureux dans son entreprise ne rend pas plus performant : « C’est au contraire l’inverse : c’est lorsqu’ils ont la possibilité d’être performants qu’ils sont heureux. Le bonheur est la conséquence et non la cause. Nous sommes heureux dans notre vie quand on a réalisé ou obtenu quelque chose. » Le bonheur n’est donc plus une utopie si on l’envisage sous ce prisme. « Ce qui est terrible, c’est qu’il est devenu une norme procédurale. »
Agir pour être heureux
Le bien-être au travail, Julia de Funès le situe donc dans une logique de l’action, à l’inverse de cette logique procédurale : « Il faut avoir les capacités d’agir pour se sentir bien. L’action au sens philosophique, c’est être acteur et auteur de sa vie. On n’agit pas si on ne prend pas un risque, ce qui est compliqué en France où l’on a peur de l’échec. Risque qui doit être assorti d’une intelligence d’action en fonction du sens de la situation, pour ne pas appliquer comme une machine et retourner un obstacle en opportunité. » L’action suppose également du sens : il faut pouvoir répondre à la question « Pourquoi je fais ça ? » « Le sens est toujours une extériorité, c’est pour cette raison qu’il est si difficile pour une entreprise de donner du sens : parce qu’aujourd’hui, ce qui mène la danse, c’est la concurrence généralisée et le marché économique. Or pour performer et perdurer, les entreprises sont obligées de techniciser les métiers. Et la technique, c’est l’exact opposé du sens, c’est un moyen et en aucun cas une fin en soi. Mais les collaborateurs ont besoin de concrétiser le résultat de leurs actions pour se sentir bien… »
Aujourd’hui, les individus se retrouvent seuls face à eux-mêmes et le sens s’individualise, sans autorité transcendante guidant nos existences. « Et l’entreprise doit néanmoins avoir un projet commun, la difficulté pour les dirigeants et managers, c’est qu’ils doivent allier en permanence le projet individuel de chacun avec ce projet collectif. » Dernière condition du bien-être : pour agir, il faut avoir une certaine dose de confiance, en soi et dans les autres : « Quand on croit, on ne sait pas, croire c’est toujours une incertitude et une prise de risque. La confiance est performative, elle incite à prendre des décisions et à agir. » Il faut donc impérativement laisser les salariés agir à partir d’eux-mêmes, leur laisser une liberté d’action, redonner du sens aux métiers et fonctions, pour que le bonheur investisse le monde de l’entreprise.
Amélie Péroz
Photo Crédit Medef Somme
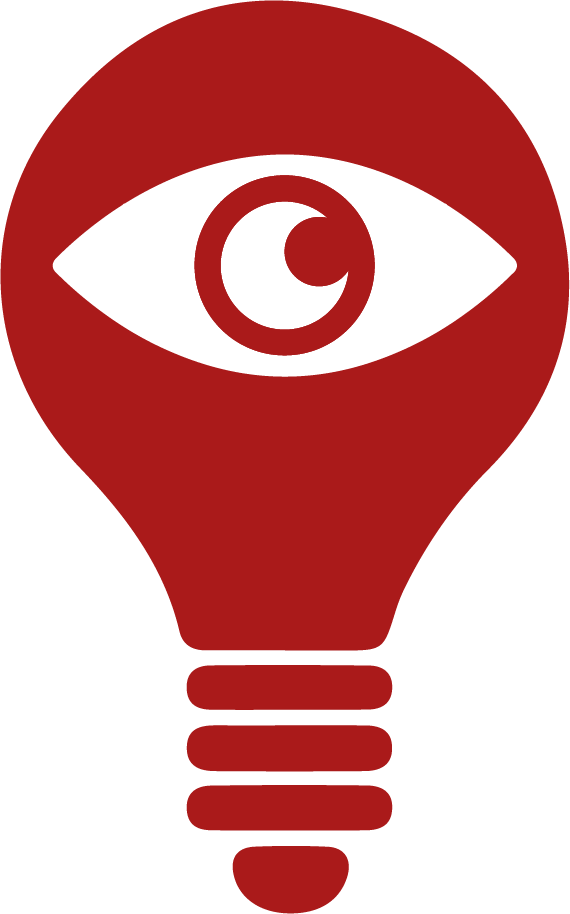
En savoir plus sur l’approche coaching de Co’Delta

